le pouffre bleu
Des fois j’oublie des , d’auters fois je mélnage leurs lettres.
- 40 Posts
- 47 Comments

 4·9 months ago
4·9 months agoEspérons que la gauche la joue bien et met le nez de la majorité le caca de son gouvernement qui n’a pas voulu suivre la résolution de l’AN et qui aurait permis d’éviter ce moment affligeant pour pas laisser le RN seul sur la scène.
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/alt/endometriose_affection_longue_duree

 10·9 months ago
10·9 months ago“On a pas attendu le RN pour le faire”
Le problème c’est justement qu’ils attendent le RN pour le faire. Le décret dont il est question, aurait pu être passé plus tôt puisqu’il s’agit de suivre une résolution de l’AN votée en début d’année,au final c’est parce qu’ils n’ont pas voulu suivre et donner du crédit à une initiative de la nupes que la condition des femmes de s’améliore pas et si le RN n’avait pas fait son move, ils n’envisageraient pas faire ce décret…
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/alt/endometriose_affection_longue_duree

 2·9 months ago
2·9 months agoJe ne suis pas sur de comprendre de ce que tu veux dire par " qui trouvent une faute chez les autres", je vous pas en quoi elle a un discours “vous avez tord et j’ai raison” mais plutôt vous vous focalisez sur une partie d’un problème plus large…

 1·9 months ago
1·9 months agoPour le coup je dirai pas que c’est ultra détaillé, il y a plein de pays dans d’autres région du monde (MO surtout) avec des problématiques similaires et leur propres spécificités

 5·9 months ago
5·9 months agoAprès plusieurs mois de test, Google, Adobe et Microsoft ont annoncé la fin de la période d’essai gratuite. Pour continuer à profiter de leur intelligence artificielle respective, il va falloir payer.
Ca ressemble quand même vachement au cliché du dealer qui file des échantillons gratuits et commence à fait payer une fois qu’on est accro…
Question : je suppose que pendant cette période d’essai les entreprises ont fait de report de bug et autres problèmes, peut être des suggestions d’ergonomie et de fonctionnalités, en gros Google, Adobe et Microsoft ont fait travailler pour elles ces entreprises sur une échelle et sur des problèmes spécifiques concrets qu’elles ne peuvent pas “simuler” elles-mêmes, pour créer un produit finit avec une plus grande VA avec comme “rétribution” l’usage temporaire de leur outils qui entraine mécaniquement un changement d’organisation interne de la manière de travailler ?

 7·9 months ago
7·9 months agoLa question du voile est-elle la même ici qu’en Iran ?
Évidemment que non, l’extrait partagé le montre bien mais je suppose qu’en lisant le bouquin tu auras peut être une réponse plus détaillée. Là-bas comme ici d’ailleurs, j’ai l’impression qu’il y a pas une question du voile mais des questions en fonction de qui les posent. En France, elles sont surtout poser par des [edit]non musulmans de tout bord, et assez peu par les premières concernés : les femmes française (ou résidentes en France) musulmanes qui ne sont évidemment pas un groupe homogène.
En Iran et dans d’autres pays, le voile est le symbole d’un pouvoir religieux étatique (comme expliqué dans l’extrait) et parfois utilisé comme un symbole contre un pouvoir religieux qui veut concurrencer le pouvoir étatique comme en Égypte récemment avec le niqab. Égypte. Fin du niqab à l’école : le général al-Sissi durcit sa ligne face aux Frères musulmans
Discrimination liée au voile islamique en Égypte : des femmes portant le hijab victimes de préjugés
Que ce soit ici ou “là-bas” le point commun sur ces questions me semble être le fait qu’on impose; parle à la place et pour les femmes concernées sans vraiment le donner la parole…
Ca me semble quand même être une question ou le religieux et le politique se mélangent et qu’en fonction du moment un aspect modifie le sens de l’autre pour servir son récit en rapportant souvent des faits divers…
C’est assez dure de trouver des sources en français qui traite ce sujet à l’international (et encore plus au national) qui n’ont pas de gros biais qu’importe le sens.
DU NOUVEAU CHEZ DIEU. En Indonésie, le voile se porte au pluriel, 2003
L’Indonésie interdit le hidjab obligatoire dans les écoles
Le port du jilbab en Indonésie : entre religion et politique
Indonésie : Une école rase la tête d’élèves accusées de mal porter le voile
…
Hijab as a Muslim Attire and a Fashion Trend in Bangladesh
Hijab popularity budding among educated women in Bangladesh
…
Algérie: des femmes en campagne contre le port du voile
En Algérie, des femmes souhaitent un retour au voile de leurs ancêtres
…
https://www.slate.fr/story/199275/islam-haik-musulmane-voile-visage-guerre-algerie-colonial (pour une réflexion plus large que celle centrée autour de l’actualité)

 3·9 months ago
3·9 months agoIl met la charrue avec les bœufs. Il répond à la question “comment produire” avant de poser les questions qui doivent la précéder : “pourquoi” et “pour qui”…
Je dirai même qu’il s’emballe avant même l’utilisation de la charrue et qu’il sème sur une parcelle avant de l’avoir défriché. Parce qu’il pose pas non plus la question du “comment du comment” sa solution se met en place.
Est-ce que je me répète ? Totalement, j’assouvis juste mon envie matinale de métaphore.

 5·9 months ago
5·9 months agoJe dirais que ça n’a pour le moment rien à voir avec ce que dit Jancovici. Les profits des entreprises sont encore très importants. On est plus sur un conflit de répartition des richesses que sur un appauvrissement général.
Je vois plus ça comme un angle mort des réflexions que nous propose Jancoco.
Il est trop orienté vers une réflexion basée des bilan d’émission, de quantité d’énergie dispo etc et sur la technique et les solutions qu’elle nous apporte et élude totalement les questions de rapports de forces politiques et de domination entres les groupes d’individus et les nations… Un appauvrissement général n’est malheureusement pas incompatible avec une réparation toujours inégalitaire et une concentration de richesses importantes quand le reste de la population voit ces conditions de vie. C’est même une perspectives qui peut pousser un chercher à accroitre le plus possible avant que ça ne le soit plus…
C’est ce que je reproche à Jancovici c’est qu’il évacue le fait que ces inégalités sont pensées et organisées et que les solutions qu’il met en avant vont contre cette organisation inégalitaire. Or les gagnants et tenants de ces inégalités préféreront choisir leur maintient plutôt que de renoncer à leur pouvoir économique et leur conforts de vie, sa transition à pour principal obstacle une lutte qu’il ne nomme pas, on peut pas gagner si on ne nomme pas ses ennemis.
I’am pretty sure you get what I mean. I can’t speak in the name of the guy and since he didn’t developed his point or give references I can only assume what he mean’t and I can be wrong, yet the statement in itslef is not wrong.
I developed a bit more my point and gave you a reference that leads to more references if you find the subject interessting…
It’s kind of ironic from you to complain about and empty conversation and do the exact same thing right after.
Our boy Socrates was 2200 years too early, he might have learnt from ours boys Charles Fourier, Bakunin, Marx and others that democracy is never an accomplished regime, it needs to be defended at all time in a ceaseless battle against the worst parts of mankind, against our own turpitude and weakness, it’s an everlasting revolution that dies as soon as it starts to be content with itself.
Not sure to what actually he’s refering to but he’s not wrong though. The foundation of ours “western liberal democraties” wasn’t really the ideal we have today about what democracy is or even worst it wasn’t either the preffered regime of a large part of the rulling classes at that time.
In order to not have an empty conversation :

 5·9 months ago
5·9 months agoVivre dans un petit village de campagne ça n’empeche pas d’être dans un petit appartement ou une vielle maison de ville et pas avoir de la place.
Pour acheter en gros, en plus de place pour stocker, faut payer le transport et surtout pouvoir se le payer, quand t’es en galère des fois tu es obligé d’acheter de plus petites quantités mêmes si c’est plus cher au kilo parce que les plus grosses quantités sont au dessus du budget…
Quand tu es en galère, que ce soit en ville où à la campagne il y a rien qui est facile…

 2·9 months ago
2·9 months agoOuais c’est de la gentrification en gros. On fait venir des patrons bobos à coup d’aides a l’installation, et ils réservent tous les “vrais” emplois aux neo-ruraux qui leur ressemblent et qui voudront bien les rejoindre.
Et ceux qu’on prétendait aider a la base, on leur garde les cdd/interim tout merdiques et sous-payés que personne voudrait faire si ils avaient le choix. En grattant des aides type “contrat aidé” évidemment, et en évitant soigneusement de les former pour pouvoir recommencer à l’infini.
C’est un risque certain mais pas une fatalité non plus, ça dépendrait je pense énormément de qui, pourquoi et pour qui une telle dynamiques seraient promues…
Le racisme type facho haineux j’en ai vu qu’en ville. La campagne c’est plutôt les préjugés a la papa/beaufs des anciennes générations, ils se remettent un peu plus facilement en question.
Là je suis partiellement en désaccord, c’est vrai que le groupuscule facho/haineux actifs et visible ont plutôt l’être d’être urbains, je dirai pas pour autant qu’il y moins ou plus de racisme dans les campagnes. Les “blagues” à base de préjugés sont aussi bien faîtes par des plus jeunes que des anciens, sans parler des reprises de ce qu’on voit à la TV pour dire que les banlieues et les pas gaulois foutent trop le bordel et respecte pas la France… Et j’ai du mal avec l’idée que qu’on vote pour le RN sans ne pas cautionner son racisme ou à minima trouver que “c’est pas si grave, ça nous touche pas vraiment”…
et y’a pas d’économie souterraine en dernier recours
Si par économie souterraine tu fais référence aux trafics de drogues, là aussi je suis en partie en désaccord, certes pas dans le même proportion mais la drogue (pas que l’herbe et l’alcool) et aussi très présente dans les campagnes…
Quand ils vont commencer à jouer aux cons avec le RSA, je vous dis pas comme ça va péter
J’ai aussi peur de voir des discours de “nous au rsa à la campagne exploités” (à raison) contre “eux des banlieues assistés qui visent au crochet des allocs” avec le bon fond de racisme qui va avec se répandre…

 3·9 months ago
3·9 months agoL’Efsa n’est-elle qu’une caution pour légitimer des pratiques toxiques sur le sol européen ?
Ce serait pire si l’Efsa n’existait pas. Mais il faudrait qu’elle remplisse son rôle, avec de réelles expertises indépendantes et scientifiquement fondées. La base serait que les tests d’innocuité ne soient plus faits par les industriels mais par des laboratoires indépendants, et que ceux-ci fassent les manipulations expérimentales. Actuellement, ce sont les industriels qui font eux-mêmes les manipulations à partir de leurs propres données. Les résultats, non vérifiables car confidentiels, peuvent être truqués. C’est ce qu’a montré le chercheur Christopher Portier, qui a témoigné dans des procès aux États-Unis. En 2020, reprenant les études réglementaires faites par les industriels sur des rongeurs, il a montré que le glyphosate était effectivement cancérogène chez ces animaux.
Les industriels tournent l’interprétation des données dans le sens qu’ils veulent de façon complètement opaque. On peut même voir dans les dossiers des chiffres ou des conclusions grossièrement modifiés. C’est d’une médiocrité inentendable scientifiquement et inacceptable pour la société, qui attend protection des agences sanitaires. Il est choquant de voir que les rapporteurs de l’Efsa et de l’ECHA ne font pas le travail qu’a fait Christopher Portier.
L’Efsa et l’ECHA me donnent l’impression de nous jouer un numéro de claquettes ou de prestidigitation. On fait semblant de faire des expertises scientifiques pour, au bout du compte, autoriser un produit sur des critères politico-financiers.
Amélie Poinssot, 20 septembre 2023 à 13h39

 4·9 months ago
4·9 months agoLe risque de cancer est-il le seul problème posé par l’utilisation de glyphosate ?
Non, le débat se cristallise là-dessus car, au niveau européen, un classement du glyphosate dans la catégorie des substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction – ce que l’on appelle les « CMR » – ou sa classification comme perturbateur endocrinien entraînerait une interdiction du produit sur le marché. Mais se focaliser là-dessus occulte les autres effets du glyphosate, qui sont très graves également.
La littérature scientifique est convergente sur le fait que c’est un perturbateur endocrinien, c’est-à-dire qu’il a des effets sur la fertilité et la formation du fœtus. C’est aussi un produit neurotoxique, c’est-à-dire qu’il endommage le système nerveux. Et c’est une substance néfaste pour notre microbiote : l’herbicide étant un antibiotique, il attaque nos bactéries intestinales. Ce déséquilibre dans l’organisme peut rendre les gens plus vulnérables à différentes maladies métaboliques comme l’obésité, le diabète, ou encore la stéatose [accumulation de graisses dans le foie – nldr].
Le glyphosate est en outre néfaste pour les écosystèmes : il appauvrit les sols ; il pollue l’eau, ce qui entraîne une toxicité chez les poissons ; il pollue l’air, ce qui peut être toxique pour les abeilles… De nombreuses études scientifiques ont été produites sur ces impacts ; ces données, comme celles sur le microbiote, ont été complètement marginalisées dans l’évaluation faite par l’Efsa.
Enfin, au-delà du glyphosate, les coformulants qui accompagnent la molécule dans le produit qui est vendu sur le marché aggravent sa nocivité. C’est ainsi que le Roundup se révèle plus toxique que le seul glyphosate.Pourquoi l’évaluation de l’Efsa ne tient-elle pas compte d’une grande partie de la littérature scientifique ?
L’Efsa peut choisir le corpus qu’elle veut, selon la pertinence et le « poids de la preuve ». Elle privilégie les expérimentations qui respectent ce que l’on appelle les « bonnes pratiques de laboratoire », c’est-à-dire les protocoles de toxicologie traditionnels établis dans les années 1970. Ceux-ci ignorent tout un tas d’aspects, notamment ce qui touche au microbiote et à l’épigénétique.
Les industriels peuvent appliquer facilement ces protocoles, tandis qu’une grande partie de la recherche académique ne le fait plus car cela n’apporte rien aux qualités des études revues par les pairs. Donc l’Efsa écarte énormément de résultats scientifiques et retient les dossiers montés par les industriels eux-mêmes, qui fournissent leurs propres séries de manipulations en laboratoire.
Cette ignorance dépasse l’entendement. Mais si nous, chercheurs, mettions de côté 90 % de la littérature scientifique dans une étude, nous ne pourrions pas publier ! Une réautorisation du glyphosate en Europe sur la base des avis de l’Efsa et de l’ECHA [l’agence européenne des produits chimiques qui classe les cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques – ndlr] ne serait pas une décision basée sur la science. L’évaluation faite par ces agences européennes ne correspond à aucun canon scientifique, et pour la biologiste que je suis, ce processus est une truanderie.
Car aux côtés de l’Efsa, l’ECHA fonctionne de la même façon : elle choisit ses études et retient principalement les dossiers présentés par les industriels. Elle a conclu que le glyphosate n’était ni cancérogène, ni perturbateur endocrinien, ni reprotoxique.
Si les évaluations de l’Efsa et de l’ECHA reposaient sur la science, le glyphosate serait interdit depuis des décennies. Le combat n’est pas là, en réalité. Il est du côté des intérêts économiques et politiques.
Des substances ont fini par être interdites après quinze ans d’utilisation, sur la base des mêmes dossiers réglementaires qui justifiaient leur utilisation. Elles ont fini par être été classées CMR lorsque le marché économique l’a permis. C’est ainsi que l’isopyrazam, un fongicide [produit qui s’attaque aux champignons – ndlr], a été classé comme reprotoxique et interdit en 2022, sans que de nouvelles données aient été apportées à son sujet. Simplement, il n’y avait plus aucun produit contenant cette molécule sur le marché. Un produit est généralement interdit quand son intérêt agronomique a disparu ou quand la profession agricole lui a trouvé un substitut.
Malheureusement, le cas du glyphosate illustre au plus haut degré que les preuves en biologie ne servent à rien pour protéger le vivant, elles ne pèsent pas sur les réglementations ni sur les décisions. Cela m’amène, aujourd’hui, à orienter mes recherches vers l’effacement de la connaissance scientifique au cours des processus d’évaluation par les agences réglementaires. Cet effacement est d’autant plus déplorable que les scientifiques comme moi sommes agents de l’État, autrement dit c’est du gâchis d’argent public et c’est un échec criant de la démocratie sanitaire.
Le gouvernement français, cependant, n’est pas obligé de suivre l’avis de l’Efsa… Et même si une majorité se dégage au Conseil européen en faveur d’une réautorisation, un État membre peut interdire le glyphosate sur son sol. C’est ce que prévoit de faire la coalition au pouvoir en Allemagne.
Si le gouvernement français était favorable à une sortie du glyphosate, s’il voulait prendre en compte la science, nous l’aurions vu. Les plans Ecophyto n’ont pas abouti à une réduction significative de l’utilisation de pesticides. La science est sous ses yeux, pourtant. L’Inrae dont je dépends a réalisé, dès 2017, un scénario d’agriculture sans glyphosate. Il a fait le travail. De la même manière que la culture de betteraves sucrières peut se passer des néonicotinoïdes, il y a des alternatives au glyphosate. La proposition de la Commission européenne de rembrayer sur une autorisation, qui plus est sur dix ans, montre que c’est l’économie qui prime.

 7·9 months ago
7·9 months ago« Si les évaluations européennes reposaient sur la science, le glyphosate serait interdit depuis des décennies »
L’Efsa, l’Autorité européenne de sécurité des aliments, estime que l’herbicide le plus vendu au monde ne pose pas de risque majeur pour la santé humaine. Mais pour Laurence Huc, toxicologue et spécialiste des pesticides, cette évaluation « ne correspond à aucun canon scientifique ».
Science ou lobbying industriel ? Le maintien du glyphosate sur le marché européen est en cours d’examen à Bruxelles. Cet été, l’Efsa, l’Autorité européenne de sécurité des aliments, a rendu son avis : selon l’agence, l’herbicide ne présente pas de « domaine critique de préoccupation » empêchant le renouvellement de son autorisation. Suite de la procédure vendredi 22 septembre, avec la proposition de texte de la Commission européenne qui, d’après nos informations, pourrait ouvrir la voie à un renouvellement de l’autorisation pour dix ans. La nouvelle réglementation sera soumise au vote des Vingt-Sept lors du Conseil européen des 12 et 13 octobre prochains.
La dernière fois que les États membres avaient statué sur le sujet, il y a six ans, le maintien du glyphosate sur le marché était pourtant passé à un cheveu : la majorité qui s’était dégagée au Conseil européen ne reposait que sur 65,2 % de la population de l’Union, pour une majorité qualifiée fixée à 65 %. La France avait voté contre.
Depuis, Paris a fait volte-face. Marc Fesneau, le ministre de l’agriculture, l’a dit à Ouest France le 12 septembre : « Tout converge vers une nouvelle homologation. » Son argument ? « On fait confiance à la science, aux études qui disent que le glyphosate ne pose pas de problème cancérogène. » C’est également ce qu’avait dit la première ministre Élisabeth Borne au Salon de l’agriculture en février : « En matière de produits phytosanitaires […], notre approche est fondée sur la science et les avis des scientifiques. »
Mais que dit la science précisément ? L’état de la connaissance actuel diverge en réalité de l’évaluation faite par l’Efsa, et un certain nombre de pathologies ont déjà été identifiées. Entretien avec Laurence Huc, toxicologue et spécialiste des pesticides à l’Inrae, l’Institut national pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement.
Mediapart : Que sait-on des effets du glyphosate sur la santé humaine ?
Laurence Huc : Le glyphosate est le pesticide le plus utilisé au monde. Il existe donc une grande littérature scientifique à son sujet, à la différence de nombreuses substances actives sur lesquelles on ne sait rien. Mais cette molécule est aussi au cœur d’enjeux financiers importants. Quand, en 2014, le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a annoncé qu’il allait produire une monographie sur le glyphosate – qui a abouti à sa classification en 2015 comme cancérogène probable –, les industriels se sont mis à produire des publications minimisant les effets toxiques, selon la même stratégie que le lobby du tabac : la production de doute par la science. Soit les auteurs de ces publications étaient en conflit d’intérêts, soit les publications étaient « ghostwritées » – autrement dit : des scientifiques ont prêté leur nom pour signer des études écrites par les industriels eux-mêmes. Tout cela a créé un « bruit d’information », comme quoi on ne saurait pas vraiment, il y aurait des résultats dans un sens et dans l’autre…
Le chercheur Charles Benbrook a analysé toute la littérature sur les liens entre glyphosate et génotoxicité - c’est-à-dire des altérations de l’ADN pouvant induire des cancers. Selon cette analyse, quand les auteurs des publications ne sont pas en conflit d’intérêts, 75 % des études concluent à un effet génotoxique du glyphosate sous la forme commercialisée du Roundup [l’herbicide de Bayer Monsanto – ndlr] .
L’expertise de l’Inserm sur les pathologies liées aux pesticides, en 2021, le dit aussi : l’exposition au glyphosate augmente les risques, pour les agriculteurs et agricultrices, de développer le lymphome non hodgkinien [un cancer du sang – ndlr]. Nous sommes à un niveau de présomption moyen. De plus, on a observé des cancers chez les rongeurs. C’est suffisant pour faire appliquer le principe de précaution. Des études académiques utilisant d’autres modèles, comme le développement cellulaire en laboratoire ou les poissons zèbres, aboutissent à la même conclusion. Enfin, deux autres publications importantes : la méta-analyse épidémiologique de 2019, qui reprend toute la littérature et les statistiques sur les populations d’agriculteurs exposés au glyphosate et établit un risque augmenté de 40 % de développer le lymphome non hodgkinien, et une analyse groupée de la plus grande cohorte internationale d’agriculteurs - plus de 3 millions d’individus suivis –, qui montre un risque augmenté de 36 % pour le type de lymphome non hodgkinien le plus courant. Ces données ne font que renforcer les niveaux de preuve du caractère cancérogène du glyphosate pour la population humaine que le CIRC avait déjà pointé en 2015.

 2·9 months ago
2·9 months agoje trouve qu’il y manque une perspective.
J’ai plus le sentiment qu’ils jouent bien leur rôle mais qu’ils sont seuls sur scène. Ça reste des humains avec du temps et de l’énergie limités. Ils font un travail de veille et d’alerte, argumentent leurs positions mais on peut pas compter que sur eux pour voir ces sujets s’imposer où à minima leur donner de visibilité et là le personnel politique a son rôle à jouer, je ne parviens pas à m’expliquer pourquoi à gauche les différents partis ne s’en emparent pas d’avantage. Peut être que La Quadrature entretient pas ou peu de relation avec la classe politique (celle qui a accès aux medias) et pourrait s’améliorer sur ça mais j’en veux d’avantage aux politiques et aux médias de pas plus leur donner la paroles, et aussi évidement à nous autres citoyens aliénés avec cet étrange fantasme que si on vit en démocratie alors ce qu’il s’y passe ne pas pas être dangereux pour la démocratie.

 41·9 months ago
41·9 months agoGlyphosate : entre l’Inserm et les agences réglementaires, des conclusions divergentes
Dans un rapport publié mardi, Générations futures interroge le corpus scientifique sur lequel se fondent les agences réglementaires européennes d’une part, et l’Inserm d’autre part, pour expertiser les effets de l’herbicide sur la santé.
Dans les prochaines semaines, la Commission européenne devrait proposer aux Etats-membres de réautoriser le glyphosate jusqu’en 2038, sur la foi de l’expertise rendue par les deux agences réglementaires de l’Union européenne – l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA). Dans un rapport rendu public mardi 12 septembre, l’association Générations futures interroge ces travaux, en comparant leurs conclusions avec celles de l’expertise collective rendue par l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) en juin 2021.
Le constat est celui de profonds désaccords entre les deux expertises – Inserm d’une part, agences réglementaires de l’autre – sur les effets examinés. Que ce soit sur la génotoxicité (toxicité pour l’ADN), la neurotoxicité (toxicité pour le cerveau), la reprotoxicité (toxicité pour la reproduction) et les effets de perturbation endocrinienne, ou encore la mitotoxicité (toxicité pour la respiration cellulaire) ou la toxicité pour le microbiote, les agences réglementaires ne mettent pas en évidence d’effets probants, tandis que les experts réunis par l’Inserm citent de nombreuses études mettant en évidence de tels dangers.
« L’une des raisons de cette divergence est le fait que les agences réglementaires jugent non fiables ou non pertinentes l’écrasante majorité des études universitaires, explique Pauline Cervan, ancienne toxicologue pour l’industrie chimique, désormais chargée de mission à Générations futures. Pour l’ensemble des effets que nous avons analysés, l’Inserm s’est appuyé sur quarante-cinq études académiques, mais une seule d’entre elles a été jugée pertinente et fiable par les agences. Celles-ci considèrent en priorité les études standardisées que leur fournissent les industriels. »
« Déficits locomoteurs » et « comportement dépressif »
Par exemple, pour forger leur opinion sur la génotoxicité du glyphosate, les experts de l’Inserm ont pris en compte dix-huit études académiques dont aucune n’a été retenue par les agences réglementaires. « Il est peu probable que le glyphosate soit génotoxique sur la base d’une approche de type “poids de la preuve” », écrit ainsi l’EFSA dans son rapport final, publié en juillet. L’expertise de l’Inserm conclut à l’exact inverse : « De nombreuses études mettent en évidence des dommages génotoxiques [qui] s’ils ne sont pas réparés sans erreur par les cellules, peuvent conduire à l’apparition de mutations et déclencher ainsi un processus de cancérogenèse. » Les auteurs ajoutent que ces effets sont cohérents avec le stress oxydant induit par le glyphosate « parfois à des doses d’exposition compatibles avec celles auxquelles les populations peuvent être confrontées ».
De même, pour le potentiel de perturbation endocrinienne, l’Inserm a considéré vingt-et-une études publiées dans la littérature scientifique pour forger son opinion. Les agences en ont jugé une seule fiable et pertinente. « L’ensemble du poids des preuves n’a pas montré de mécanisme convaincant d’activité endocrinienne », écrit ainsi l’EFSA. Là encore, l’Inserm conclut à l’inverse : « La littérature récente suggère un mode d’action PE qui pourrait agir au niveau des fonctions développementales ou de reproduction », lit-on dans son expertise collective.
Quant à la neurotoxicité, les agences réglementaires jugent que « les éléments de preuve d’un effet du glyphosate ou des herbicides à base de glyphosate sur les neurotransmetteurs sont insuffisants ». Autre son de cloche du côté de l’Inserm qui note, dans les commentaires que l’institution a adressés aux régulateurs européens, que « des études universitaires récentes ont montré que les herbicides à base de glyphosate ainsi que le glyphosate seul modifient les concentrations de plusieurs neurotransmetteurs dans diverses régions du cerveau chez les rongeurs ». « Cela pourrait expliquer les déficits locomoteurs et le comportement dépressif observés chez les rongeurs exposés », ajoutait l’institut.
« Aucun résultat important n’a été écarté »
D’autres effets toxiques relevés dans le rapport de l’Inserm, sur de possibles modes d’action épigénétique, sur la toxicité pour la respiration cellulaire ou les effets sur le microbiote intestinal n’ont pas été recherchés par les agences. Interrogée, l’ECHA explique avoir mené une évaluation « fondée sur le “poids de la preuve”, ce qui signifie que les études bien réalisées et standardisées ont généralement plus de poids dans l’évaluation ». « Aucun résultat important n’a été écarté », ajoute-t-on à l’ECHA. L’agence précise que « l’étude du microbiote intestinal ne fait actuellement pas partie du cadre européen d’évaluation des pesticides et que, par conséquent, ces études n’ont pas été prises en compte dans l’évaluation ».
L’EFSA, de son côté, estime que son rapport final publié en juillet est « l’évaluation la plus complète et la plus transparente d’un pesticide jamais réalisée par l’EFSA et les Etats membres de l’UE ». « Les experts ont évalué une série d’études publiées dans la littérature scientifique et des études réglementaires pour parvenir à leurs conclusions », ajoute-t-on à l’agence basée à Parme (Italie).
Par Stéphane Foucart , publié le 12 septembre 2023 à 07h00, modifié le 12 septembre 2023 à 10h00
Rapport dispo sur le site le site de Générations futures

 2·9 months ago
2·9 months agoMerci pour le complément




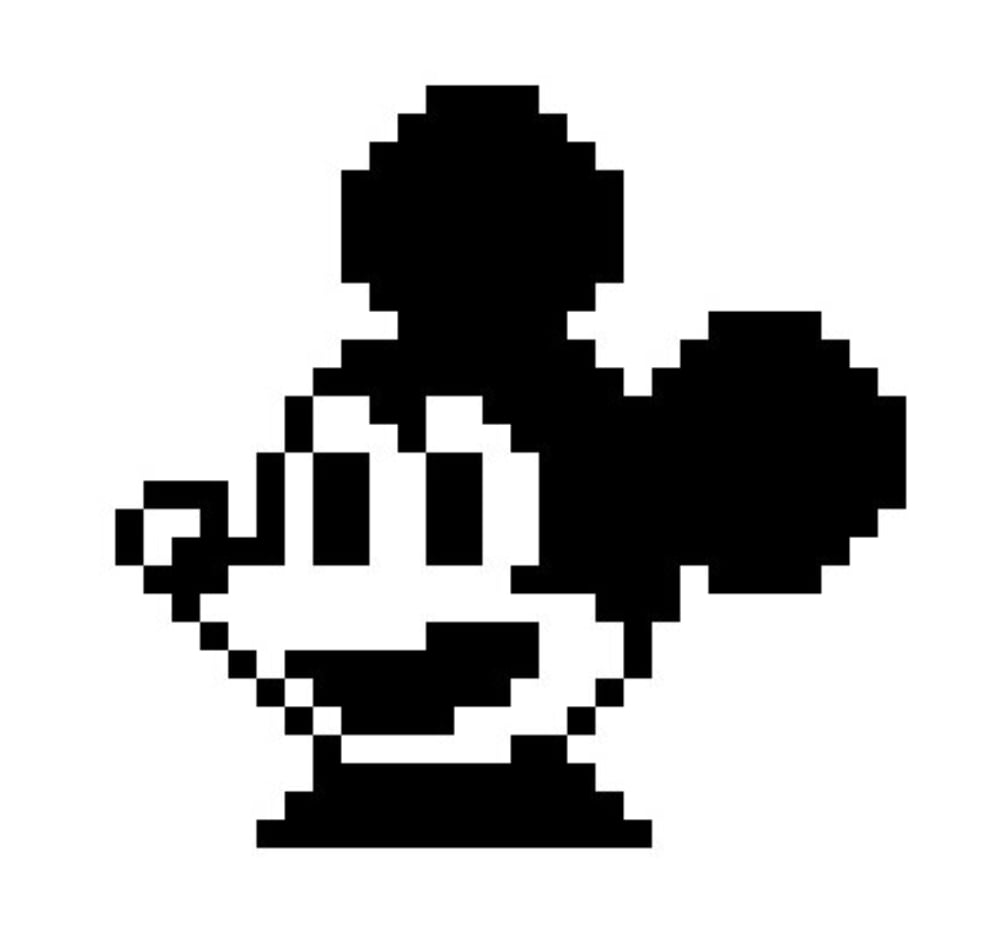

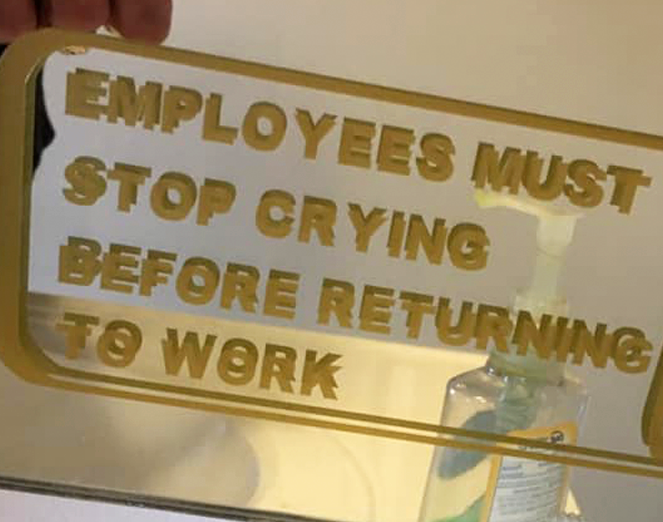
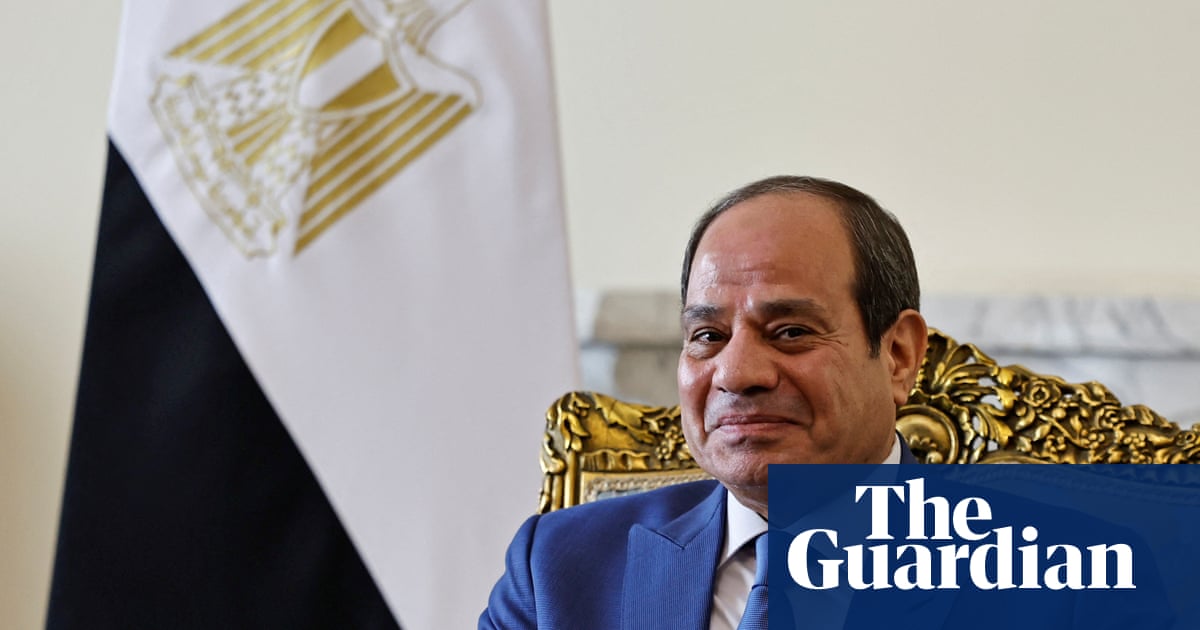




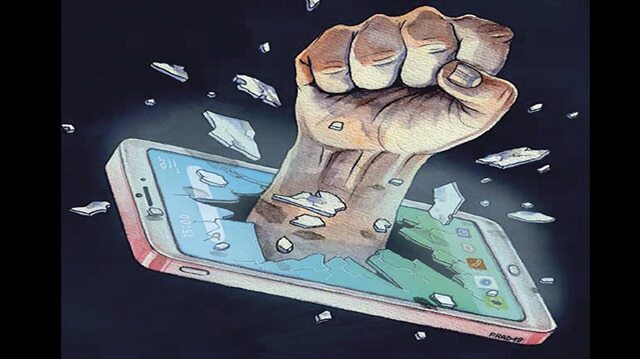





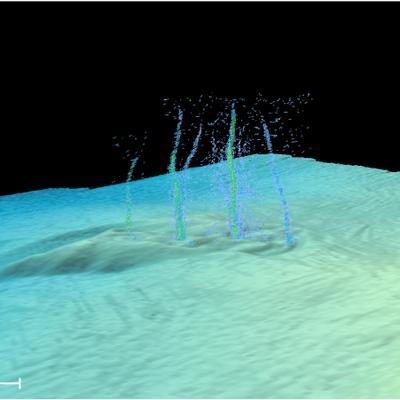


Merci pour ces infos. Depuis que j’ai vu cette année de genre d’engin avec une petite remorque/caravane autonome à la foire de Paris je remets en cause mon envie de me monter un van pour ce genre de véhicule, mais toujours avec l’envie de le monter moi même.
Ca me fait à ce qu’a fait Jacob Kahru et que j’avais partagé il y a quelques mois :
J’ai construit un Vélo Solaire Autonome
Brest-Istanbul à vélo solaire (5000 km en 32 jours)