Les affaires européennes, l’autre arène d’une éventuelle cohabitation
Quand le flou domine, autant prendre les devants. C’est ce qu’Emmanuel Macron a tenté de faire le 11 juillet dernier, en clôture du sommet de l’Otan, en laissant entendre qu’il comptait bien garder la main sur la politique extérieure, coupant l’herbe sous le pied de ceux qui voudraient lui contester certaines prérogatives : « La France a une Constitution claire en ces domaines, qui permet d’assurer la continuité de sa politique étrangère et de sa crédibilité internationale. »
Il fait ainsi référence sans le nommer au « domaine réservé » ; ces secteurs qui, comme la défense ou la politique étrangère, restent traditionnellement dans l’escarcelle du Président en cas de cohabitation.
Un usage qui relève moins de la Constitution que de la pratique du pouvoir. « Juridiquement, le domaine réservé n’existe pas », rappelle Thibaud Mulier, maître de conférences en droit public à l’université Paris-Nanterre. En matière de défense, par exemple, la répartition des tâches n’est pas univoque : si le Président a le monopole du feu nucléaire et est « le chef des armées » (art. 15), le Premier ministre, lui, est « responsable de la Défense nationale » (art. 21).
C’est pourtant en partie en vertu de ce principe – non écrit – du domaine réservé que, hors période de cohabitation, le Président a la main sur la politique européenne de la France.
Mathieu Disant, professeur de droit public à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne, parle d’« omniprésence, ou au moins de primauté présidentielle. Cela rejoint une conception héritée du général de Gaulle et de Georges Pompidou, selon laquelle la politique européenne de la France se confond avec la politique étrangère, que seul le Président peut incarner ».
En pratique, c’est le chef de l’État qui donne les grandes orientations et les feuilles de route à suivre dans les négociations au Conseil de l’Union européenne, l’enceinte où les ministres de tous les pays de l’UE se réunissent pour négocier et adopter la législation de l’Union.

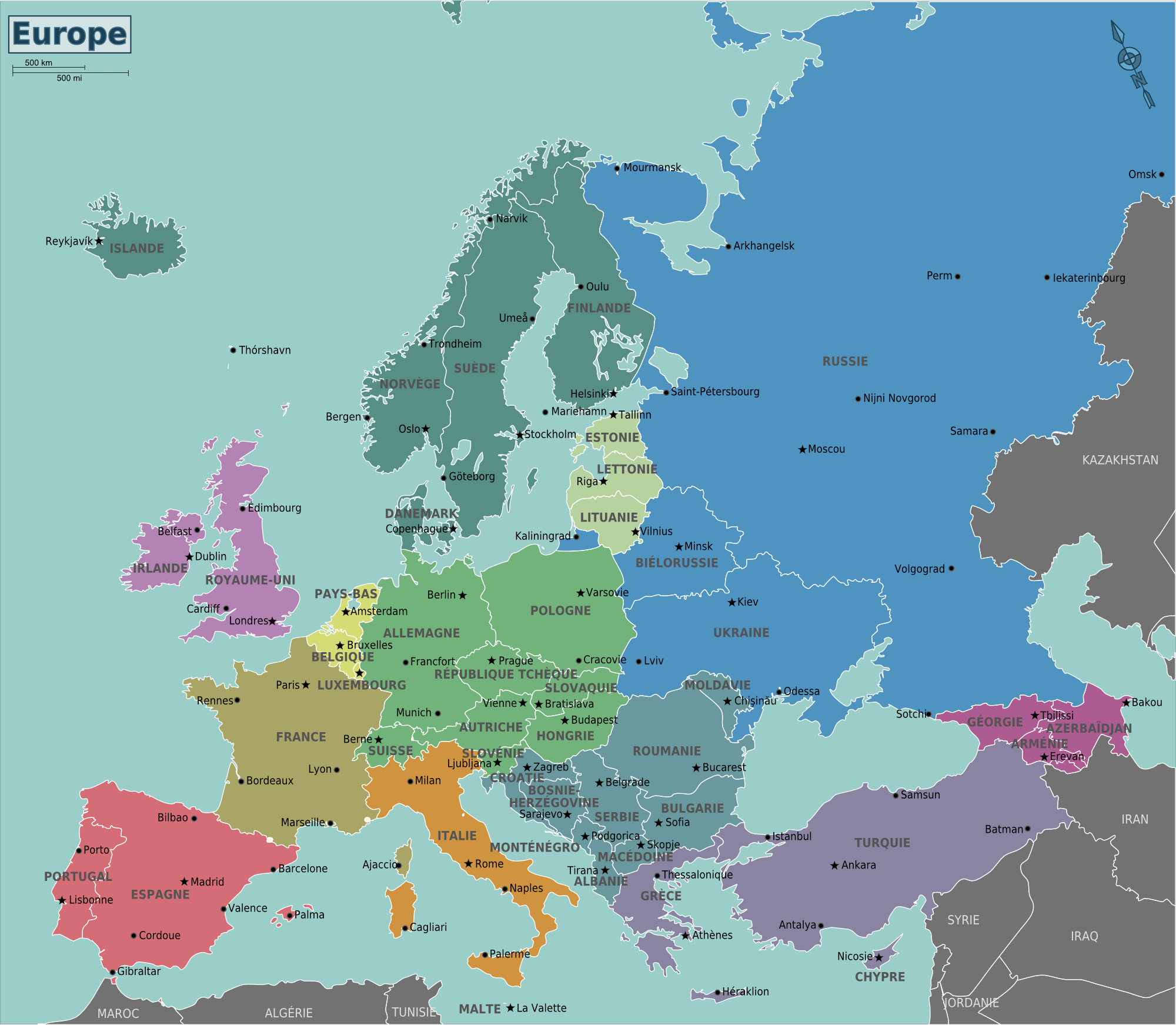

À mi-chemin entre politiques extérieure et intérieure
Pourtant, la politique européenne s’inscrit dans un cadre particulier, à mi-chemin entre la politique extérieure et la politique intérieure.
Et « la Constitution ne définit pas qui décide sur les questions européennes car les deux ont des rôles importants en politique extérieure ». D’un côté, « le président de la République négocie et ratifie les traités » (art. 52), de l’autre, le gouvernement, présidé par le Premier ministre, « détermine et conduit la politique de la Nation » (art. 20). Ce sont en outre les ministres qui siègent au Conseil de l’Union européenne, où sont négociés les textes européens côté États membres.
C’est pourquoi, selon Mathieu Disant, « la situation est beaucoup plus nuancée en période de cohabitation, sans forcément s’inverser totalement. On peut dire de façon certaine que le Président perd sa prééminence ». Matignon redevient le siège de l’élaboration de la politique nationale, mais il bénéficie aussi de ce qu’il désigne son rôle de « logisticien ».
Le Premier ministre « gère au jour le jour la politique européenne de la France avec le Secrétariat général aux affaires européennes [SGAE]. Aucun arbitrage interministériel en matière européenne n’échappe à ce dernier », détaille-t-il.
Hors cohabitation, il n’est pas rare que les conseillers élyséens s’invitent aux réunions interministérielles, permettant au Président de garder un pied dans cette machine administrative. Mais un tel accès n’aurait rien d’automatique en cohabitation.
« On a remarqué dans les précédentes cohabitations que le secrétariat général de l’Élysée a tendance à essayer d’avoir le plus d’informations possible. Et là-dessus, Matignon peut peser en évitant de l’informer, voire en ne l’informant pas du tout », relève Thibaud Mulier. Dans les faits, les rapports du couple exécutif ne se sont jamais tendus à ce point, et le Président a toujours été « informé du plus important », tempère-t-il.
« Un rapport de force »
Au-delà des textes, l’expérience montre que l’équilibre entre les deux têtes de l’exécutif dépend surtout des circonstances de la cohabitation.
« C’est un rapport de force qui dépend d’une série de critères, comme la politique interne, l’influence respective des deux acteurs, leurs réseaux internationaux ou encore leur capacité de convergence programmatique », souligne l’historien Mathias Bernard, auteur de plusieurs ouvrages sur la Vᵉ République.
Lors de la première cohabitation, François Mitterrand disposait d’un certain nombre d’atouts qui lui ont permis de s’imposer face à Jacques Chirac sur la scène européenne : son engagement européen à travers par exemple la négociation de l’Acte unique (1986), ses bonnes relations avec des personnalités comme Helmut Kohl (chancelier allemand, 1982-1998) et Jacques Delors (président de la Commission européenne, 1985-1995), ou encore l’inexpérience de son Premier ministre sur ces sujets. Cela lui a permis notamment d’exercer un véritable droit de veto sur l’identité des ministres des Affaires étrangères et de la Défense, et de s’imposer comme celui qui parle au nom de la France, y compris dans le cadre européen.
Ce premier rapport de force a marqué les cohabitations suivantes. François Mitterrand a « fixé un certain nombre de règles non écrites qui servent un peu de références », explique Loïc Chabrier, maître de conférences en droit public à l’université Lumière-Lyon II. Par la suite, le Premier ministre a su prendre plus de poids sur la scène européenne. Lors de la deuxième cohabitation, surnommée « de velours », les positions d’Édouard Balladur et François Mitterrand étaient plus proches, et le second cité, sur la fin de son dernier mandat, plus en retrait.
La troisième cohabitation est « sans doute celle où le Premier ministre a été le plus important, notamment sur les questions étrangères », affirme Mathias Bernard. D’une part car « le rapport de force en politique intérieure était favorable à Lionel Jospin », Jacques Chirac ayant perdu sa majorité en dissolvant l’Assemblée nationale. Mais aussi car cette cohabitation correspond à un moment de forte intégration – marché unique, passage à l’euro… – « où les questions européennes ont pris une sorte d’autonomie, se situant désormais à l’interface de la politique interne et de la politique étrangère, davantage contrôlée par le Quai d’Orsay ».
« Configuration nouvelle, incertitude totale »
Paradoxalement, « toute cette période de 1986 à 2002, où la France était majoritairement en cohabitation, a été une période de grandes avancées pour la construction européenne, et en grande partie portée par l’initiative française. C’est assez remarquable », relève l’historien. La France a d’ailleurs exercé la présidence du Conseil de l’Union européenne en 2000 sans tensions apparentes. En effet, à la différence de la politique intérieure, la question européenne a globalement donné « l’apparence d’une unité ».
La situation aujourd’hui semble cependant différente. En l’état actuel, aucun gouvernement n’apparaît capable de réunir une majorité absolue à l’Assemblée nationale, et aucun parti n’est capable d’assumer le pouvoir seul, comme lors des précédentes cohabitations.
« Je ne sais pas quelle marge de manœuvre aura le Premier ministre, ne serait-ce que dans son gouvernement, confesse Loïc Chabrier. On est dans une incertitude totale et une configuration nouvelle. »
Dernier scénario envisageable, dans l’éventualité où il serait impossible de former un gouvernement : le maintien d’une équipe chargée d’expédier les affaires courantes. Pour le maître de conférences, cela pourrait poser la question de la transposition des directives européennes : « Est-ce qu’on les suspend, ou est-ce que ça rentre dans la continuité de l’état ? » Du point de vue du leadership, le président de la République aurait « une forte latitude d’action sur l’aspect discursif et de représentation ; en revanche, il ne pourrait a priori rien impulser, donc la voix de la France s’affaiblirait, a minima, au niveau européen », projette-t-il.